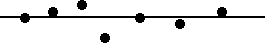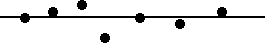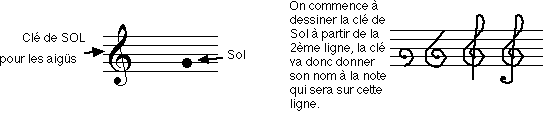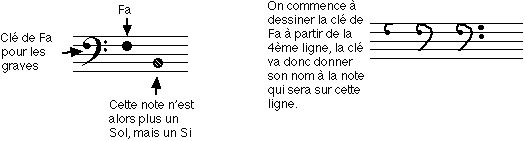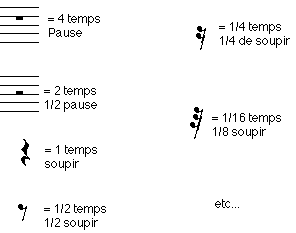Solfège n°0
Table des matières
1) La portée
2) La clé
3) La durée
4) Le nom des notes
Surtout n'y voyez rien de péjoratif, cette leçon de base est un point
de départ (à "0"), la base que tout le monde connait plus ou moins.
Mais, au cas où certains éléments vous soient obscurs, je vais
m'efforcer de vous aider à les éclaircir.
Au départ, nous chantonnons une mélodie, il y a des sons hauts et bas,
des notes qui durent plus ou moins longtemps et il ne reste plus qu'à
trouver un moyen d'immortaliser notre chef d'oeuvre par écrit. Le but
est de trouver une norme lisible par tous afin que cette mélodie soit
jouable par un musicien qui ne l'a jamais entendue.
La portée
Nous commencerons par tracer une ligne, et nous placerons un point au
dessus, sur ou en dessous de cette ligne, représentant un son plus ou
moins grave.
Cet exemple montre des notes plus ou moins haute, mais le rapport entre les notes n'est pas évident.
Par exemple :
- Nous ne connaissons pas la hauteur du son de départ (la note).
- Nous ne constatons pas la durée de chacune
- La hauteur ( l'intervalle) d'une note par rapport à une autre n'est
pas facile dans le sens où il nous est impossible de savoir combien de
notes séparent la première note de la quatrième. En effet, doit-on
descendre de 3 ou 4 sons ?
Alors, après plusieurs essais (entre 1 à 15 lignes), nous prenons en
compte 5 lignes et disposons les notes sur les lignes ou entre les
lignes.
La clé
Ce problème étant réglé, il faut déterminer à quelle hauteur de son
cela correspond car n'oublions pas qu'il existe des instruments graves
autant qu'aigus. Alors les graphistes de l'époque ont dessiné des
symboles qu'ils ont placés en début de portée.
Ensuite, pour les sons graves, nous utiliserons la même portée, mais
pas la même clé. Cela impliquera qu'une même notes ne portera pas le
même nom suivant la clé.
Alors bien sûr, le guitariste n'étant pas comme les autres déclare
qu'il devrait utiliser la clé de Fa, mais que les notes ne sont pas
bien centrées sur la portée. Enfin bref, ce n'est pas pratique. Alors,
ces mêmes graphistes lui ont permis d'utiliser la clé de Sol à
condition d'indiquer un 8 sous la clé de Sol afin de prévenir que tous
les sons ont été remontés d'une octave (8 notes, c'est dire qu'elles
portent le même nom mais qu'elles sont plus aiguës) au niveau de
l'écriture, mais pas de l'entendu.
La durée
Maintenant qu'on est au XXème siècle on peut dire "rythme", mais à
l'époque de mes graphistes, on disait "brève" ou "longue". En effet, il
y avait des notes qui durent "pas longtemps" et "longtemps". Avouez que
c'est tout de même sommaire, mais rappelez vous qu'il n'y a pas si
longtemps on s'éclairait à la bougie.
Les musiciens ont commencé a se manifester du fait que les durées
sus-citées ne suffisaient pas, qu'il fallait inventer des très longues,
des un peu longues, des longues, des moins longues .... jusqu'aux très
courtes. Alors devinez quoi ? Nos amis graphistes ont pris leur courage
à deux mains et ont d'abord trouvé la "Carré" qui dure 8 temps. Pas de
chance pour eux, on ne l'utilise plus que pour les chants Grégoriens.
Ensuite vient la ronde (4 temps), la triangle ne faisant pas
l'unanimité dans le bureau d'étude, ils ont trouvé la blanche (2
temps), la noire (1 temps), la croche (1/2 temps), la double croche
(1/4 temps), la triple croche (1/8 temps) ... le filon inépuisable qui
va continuer avec quadruple croche, quintuple etc...
Dans le bureau d'étude, l'un d'entre eux qui n'avait jusqu'alors rien
dit ni trouvé déclare en rigolant : "Vous allez voir qu'ils auront le
vice de nous demander des symboles pour les moments où ils ne jouent
pas". Tout le monde se mis à rire ... qu'il est bête ... Mais ils
baissèrent les yeux à la lecture du dernier fax émanant du musicien
leur demandant des symboles de silence.
Alors le sous-chef déclare : "bon, on fait une pause et on reprend "
Le chef répond : "non, une pause c'est trop long, je vous donne une demie pause"
... et on entend un soupir du fond de la salle...
De cette narration débute les noms des symboles demandés :
Le nom des notes
Un certain jour du XIème siècle, Guido de Arezzo, Guismo pour les
intimes, lisait un bouquin de partitions, cherchant un air à jouer pour
la fête de son beau-papa, Mr Jean. Et voilà qu'il tombe sur l'hymne à
St Jean. dont les paroles (car à l'époque, contrairement à la
variétoche d'aujourd'hui, les chansons avaient des paroles) qui
disaient :
UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tu orum
SOLve polluti
LAbii reatum
(Sancte Iohannes)
C'est du latin, ça faisait bien à l'époque. Ben voilà, ça c'est pas
mal, en plus, les notes n'ayant pas encore de nom, on va prendre les
lettres en majuscule, ça fera plus intime.
Traduction :
Afin que tes serviteurs puissent
chanter avec des voies libérées
le caractère admirable de tes actions,
ôte, Saint Jean, le pêcher de leur lèvres souillées.
Le "SI" (Sancte Iohannes) n'est arrivé qu'au XVIème siècle grace à
Anselme De Flandres et "UT" fut remplacé par "Do" en 1673 par
Bononcini, qui, pour l'anacdote, achevait un concert à l'Olympia avec
les trois notes "Ut-Ut-Ut", et le publique répliqua "ourah !". Depuis,
véxé, nous disons "Do"
leçon suivante
LE TON :
Le ton est en quelque sorte une unité de mesure. Il détermine la "distance" , l'intervalle entre deux notes.
Par exempàle , Do-Ré sont deux notes consécutives et sont espacé d'un ton.
Le ton est divisible en 2 demi-tons. En effet, prenant ce même exemple
(Do-Ré) l'intervalle d'un ton est donc partagé entre 2 demi-tons. Il
n'y a donc aucune surprise jusque là. Dans ce sens, en admettant qu'un
Do se trouve dans la première case d'une certaine corde, le Ré sera 2
cases plus loin car chaque case représente un demi-ton.
D'un autre côté, vous vous doutez bien qu'il y aurait une exception. Il n'y a pas toujours 1 ton entre chacune des notes.
Prenons l'exemple de la gamme de Do Majeur que tout le monde connait (sinon hâtez-vous)
Ainsi, d'une note à la suivante, les intervalles sont soit constitués d'un ton, soit d'un demi-ton.
Si on regarde les touches d'un piano :
nous pouvons constater une série de touches blanche, puis des petits
groupes de touches noires (par 2 ou par 3). On peut en déduir qu'il
manque une touche noire entre chaque groupe. Ceci représente les 2
emplacements des 2 intervalles qui n'ont qu'un demi-ton soit Mi-Fa et
Si-Do.
En conclusion, il y a 1 ton entre toutes les notes consécutives sauf
entre les notes qui ont un "i" et la suivante. Si cette dernière astuce
ne vous en dit pas plus, pensez à la méthode "numu" :